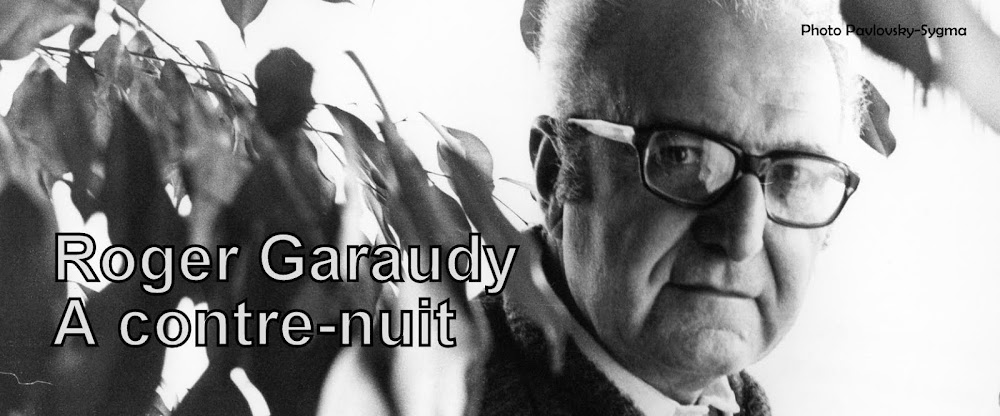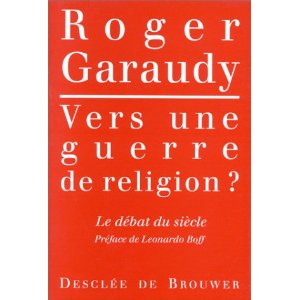Petite histoire de l’esthétique vue par les marxistes [extrait]
Les points de vue marxistes sur l’art hériteront des esthétiques philosophiques de Diderot à Kant et Hegel. Ce qui est déterminant, quelques soient les approches, des plus mécanistes aux plus complexifiées, c’est le poids de la vision dialectique du rapport forme-contenu. Nous en sortirons, précisément, avec les concepts d’Henri Meschonnic concernant l’oeuvre d’art.
J’emprunte ici la trame de cette histoire à Jean-Marc LACHAUD, auteur par ailleurs d’un Marxisme et philosophie de l’art (Anthropos, 1985), dans son exposé établi pour le Congrès Marx International de 1995, et publié sous le titre Art réalité et utopie, dans le n° 19 de la revue Actuel-Marx, sur le thème Philosophie et Politique (1996, 6 ).
La dialectique forme-contenu avant Marx
Henri Lefebvre (1901-1992) est philosophe, compagnon des premiers surréalistes, puis, comme marxiste « orthodoxe » - auteur dès l’avant-guerre d’un ouvrage sur la dialectique marxiste - avant de rapprocher Nietzsche et Marx, puis de s’éloigner du PCF pour devenir un des penseurs les plus féconds de la deuxième moitié du siècle. Il est cité par Paul Eluard dans son anthologie des écrits sur l’art (6 , p. 48 ), dans un texte (des années quarante ?) encore marqué par l’orthodoxie du philosophe :
«Diderot peut être considéré comme le créateur de l’esthétique moderne. Il a fondé sa théorie sur son expérience d’écrivain, sur ses études de critique d’art. L’échec de cette théorie n’en est que plus significatif. Diderot a posé des problèmes et n’a pu les résoudre. (...) différence entre l’oeuvre et la réalité immédiate (...) Beauté absolue et imperfection du réel, laideur des choses ...) Mais aux questions : que fait l’artiste pour « traiter le sujet (...) Comment... quels sont les passages des choses au sujet, du sujet à l’oeuvre ? » Imitation ? soumission ? transformation ? Diderot ne répond pas. « Il « oscille » entre un formalisme (expression de rapport abstrait entre les choses) et un naturalisme (expression du réel immédiat), tout en pressentant le réalisme (expression de l’essentiel).
... Diderot n’en reste pas moins le créateur génial de la critique d’art et de l’Esthétique, le grand maître du réalisme classique et critique. »
(...)
Après Diderot, dans la série des grands théoriciens de l’Esthétique, vient Kant (...) l’orientation change radicalement (...) La confrontation entre le réel et l’oeuvre devient une confrontation entre contenu et forme. La forme l’emporte, selon Kant. C’est elle qui définit l’oeuvre d’art (...) indépendamment du contenu. Par là, il a donné l’esthétique du formalisme, l’esthétique de la bourgeoisie. » L’oeuvre d’art n’a pas d’autre sens qu’elle-même. Sa fin est un jeu.
« Hegel critique les « déficiences générales du formalisme kantien (...) rétablit l’unité concrète de l’oeuvre d’art avec elle-même et les autres activités humaines (...) l’unité de la forme et du contenu, de la signification la plus profonde et de l’apparence sensible. »
Mais, pour Lefebvre, Hegel « défigure » l’esthétique comme la dialectique, par son « mysticisme spéculatif ». Il faut, avec Marx, « la renverser », lui donner un sens rationnel, critique, révolutionnaire. » (Eluard, 6 , P.48)
Marx ne pense pas l’art, mais...
Marx* n’a pas pensé l’art. Engels** non plus. * (1818-1883) **(1820-1895)
Si, pour Marx, l’art ne saurait être théorisé hors son enracinement dans l’histoire et le social, il admet des « inégalités entre l’évolution de l’art en général et celle de la société » (Fondements de la critique de l’économie politique, in Lachaud, B ,p. 142). La détermination, par l’infrastructure économique, de cette superstructure, n’est donc pas du même ordre que celle de la sphère du politique, de l’organisation sociale...
Ailleurs, on peut lire, éparses, des considérations qui nous rapprochent de la problématique baudelairienne de l’art du passé : « La difficulté ne consiste pas à comprendre que l’art grec et l’épopée soient liés à certaines formes du développement social. La difficulté consiste à comprendre qu’ils peuvent encore nous fournir des satisfactions et soient considérés à certains égards comme norme et modèle inaccessible. » (Eluard, B ,p.57)
Enfin, et dans la visée utopique, Marx pose la question de l’art et du Communisme, telle qu’elle sera reprise, presque à l’identique, par Debord, mais qui la renverse, en faisant, comme dirait Edgar MORIN, de la lutte finale une lutte initiale : « La concentration exclusive du talent artistique dans quelques individus, et son étouffement dans les grandes masses, qui en découle, est un effet de la division du travail. Si même, dans certaines conditions sociales, chacun pouvait devenir un peintre excellent, cela n’empêcherait pas chacun d’être un peintre original, de sorte qu’ici également la différence entre le travail « humain » et le travail « unique » se ramène à une absurdité. Avec une organisation communiste de la société prennent fin en tous les cas l’assujettissement de l’artiste à l’étroitesse locale et nationale, qui provient uniquement de la division du travail, et l’assujettissement de l’individu à tel art déterminé qui en fait exclusivement un peintre, un sculpteur, etc. ; ces noms seuls expriment déjà l’étroitesse de son développement professionnel et sa dépendance de la division du travail. Dans une société communiste, il n’y a pas des peintres, mais tout au plus des hommes qui, entre autres, font de la peinture. » (Marx/Engels in Eluard, B , p.57).
Esthétique et marxisme après Marx
Georges Plékhanov (1856-1918) s’empresse, dans une lecture rigide de ces fondateurs, de caricaturer cette approche de l’esthétique, privilégiant le « contenu idéologique » des oeuvres, qui détermine leur forme. Il oppose ainsi le réalisme à l’anti-réalisme, qui prolongent selon lui l’opposition philosophique entre matérialisme et idéalisme : « Il n’est pas vrai que l’art exprime seulement les sentiments des hommes. NON, il exprime et leurs sentiments, et leurs pensées ; il les exprime non pas d’une façon abstraite, mais par des images » (cité par Eluard, 6 , p.24). C’est ainsi que l’art moderne (par exemple le Cubisme) « étranger à tout ce qui se passe dans la vie sociale », ne peut déboucher que sur une « stérile répétition d’expériences personnelles dénuées de tout intérêt et de fictions d’un fantastique morbide ». (B , p.143)
Lénine (1870-1924) et Lounacharski (1875-1933), comme Trotski (1879-1940), auront d’autres chats que l’esthétique à fouetter. Le premier, dans ses écrits philosophiques, adopte la « théorie du reflet » (au sens où Marx écrit, dans Le Capital T.1 « La religion n’est que le reflet du monde réel »), pour laquelle la pensée et l’activité humaine reflètent les conditions sociales. Pour le deuxième, Lounacharski, qui s’occupera de l’Education dans le régime soviétique jusqu’en 1929, l’art est un « miroir », appelé à dévoiler, au regard des processus d’évolution de la société. Pour lui, le contenu prime sur la forme, et celle-ci, considérée en soi, ne peut conduire qu’à un abandon du réel, voire à un vide de sens. Pour l’heure, il n’est pas encore question de normaliser : de nouveaux contenus sont appelés à générer de nouvelles formes.
Trotsky est plus réservé. Le lien entre art et vie sociale n’est pas si clair. L’artiste doit bien soutenir la Révolution, mais celle-ci devrait susciter « toutes les initiatives », avec une « totale liberté d’autodétermination » (B ,p. 145). Important : le rapport contenu/forme est déterminé par « la nouvelle forme », une nécessité enracinée dans le social. Plus tard (1938), il sera co-auteur, avec Diego RIVERA (1886-1957), peintre mexicain, et André BRETON (1896-1966), d’un Manifeste Pour un Art révolutionnaire indépendant, qui est susceptible, via l’imaginaire des artistes, de favoriser l’irruption des désirs et « l’établissement d’un ordre nouveau », où l’art et la révolution libèrent d’un même pas.
Parallèlement, chez les artistes russes, la création vit des années d’une intensité extraordinaire. « Ils cherchent non pas à mettre l’art au service du pouvoir révolutionnaire, mais à réaliser, ici et maintenant, l’utopie d’une unité en mouvement unissant les puissances de l’art et celles de la vie en devenir » (B ,p. 146).
Lénine meurt. Maïakovski* se suicide. La tragédie stalinienne s’installe. * (1883-1930)
Andreï JDANOV (1896-1948), en 1934, instaure le « réalisme socialiste » comme dogme : « Connaître la vie afin de pouvoir la représenter véridiquement dans les oeuvres d’art, la représenter non point de façon scolastique, morte, non pas simplement comme la « réalité objective » mais représenter la réalité du développement révolutionnaire ». (6..., p. 147)
Du côté du « socialisme réel », tout se referme pour quelques décennies.
C’est en Allemagne que se formalisent le plus clairement les controverses politico-esthétiques. Sur le plan théorique, elles opposent le philosophe hongrois György Lukacs (1885-1971) à Ernst Bloch (1880-1959), au dramaturge Bertold Brecht (1898-1956) et au compositeur, élève dissident de Schönberg et Webern, Hanns Eisler (1898-1962).
LUKACS, contrairement à ses prédécesseurs marxistes, est un « pur » philosophe. De la totalité. Il veut favoriser un « homme global », qui la dévoile. L’oeuvre d’art offre de multiples possibilités, mais « reflète » néanmoins la vie quotidienne. Il opte pour un « grand réalisme », refusant l’abstraction et fixant à l’art une « mission d’appropriation de la façon dont est constituée la réalité objective » (B , p. 149), pour dévoiler, sous la « surface de la vie », son essence. Finalement il s’avoue, en bon hégélien, partisan d’un art pour « l’absolu », transposé de la religion dans le développement historique de la société. C’est avec ces positions qu’il s’oppose tant au « réalisme socialiste » qu’au « subjectivisme » et au « formalisme » des avant-gardes.
Précisons que ce n’est pas de ce Lukacs là, mais de ses oeuvres de jeunesse (Histoire et conscience de classe, 192 ?) que s’inspirera Guy Debord dans sa critique du fétichisme de la marchandise, qu’il généralise en critique du Spectacle.
Pour Brecht, « Il faut critiquer la réalité en lui donnant forme, il faut la critiquer de façon réaliste. C’est l’élément critique qui est décisif pour le dialecticien, c’est en lui que réside l’engagement. » (1938, in Michaud, B , p. 150). Nouveau pas dans la dialectique forme/contenu : « La forme d’une oeuvre d’art n’est rien d’autre que l’organisation parfaite de son contenu ; sa valeur dépend donc entièrement de celui-ci. » ; avec quoi il critique Lukacs, parce qu’il impose selon lui aux contenus nouveaux des formes anciennes. Nous avons vu Leroi Jones, en dramaturge comme en critique d’art et de jazz, hériter de ces positions. Pour Brecht, à chaque contenu, une forme ; mais la forme bouscule et trouble le contenu. L’art doit rechercher prioritairement la vérité . Il est source de plaisir s’il exprime un désir de libérer la vie. D’où le rôle de l’artiste, entre « élitisme de bon goût » et politisation au service des exclus. L’efficacité politique de l’art passe par la recherche de la vérité. Mais, une fois encore, le Bertold poète et dramaturge ne se réduit pas au Brecht théoricien...
Pour Ernst BLOCH, contre Lukacs, l’histoire n’a pas de déroulement linéaire. L’art ne peut traduire un totalité cohérente, une continuité, mais seulement un processus et des contradictions : une réalité brisée, hétérogène : le réel, certes, mais pas sans l’utopie, qui porte l’avenir. Chez Bloch est à l’oeuvre la tension de la modernité perçue par Baudelaire : « C’est la réalisation de l’avenir figurée par l’oeuvre qui lui assure son unité et sa totalité. Le réalisme cerne ici la progression vers le non-encore-réel. » Bloch vise un « idéal réaliste » qui libère l’espérance artistique ; ce qui l’autorise à affirmer que le sens de l’oeuvre n’est pas déterminé par son contenu, mais par l’organisation particulière de ce contenu. De ce point de vue, il dépasse la formulation de Brecht.
Avec Bloch, on sort de la caricature du marxisme : « théorie du reflet = dogmatisme = retour à la philosophie d’avant Marx. Et « l’art, comme utopie, se doit de réaliser des formes inédites » (B , p. 153)
On pense là directement au cas du jazz, quand l’oeuvre est porté par le « rêve éveillé », le « souffle de l’imagination , qui anime sa respiration, en fomentant de multiples « non-encore-là ». « Hors territoires constitués » l’oeuvre devient « fragment ultérieur (...) rebelle à toute clôture (...) entre ruine et achèvement provisoire. (...) Elle provoque son public, pour que celui-ci invente sa propre liberté » (B , p.153)
Bloch va plus loin : « L’art est un laboratoire mais aussi une fête de possibilités exécutées ainsi que des alternatives expérimentées en elles, où l’exécution tout comme le résultat se présentent comme illusion fondée, c’est-à-dire comme pré-apparaître d’un monde accompli » (Le principe Espérance, 1954). Franchement, Bernard Lubat et Uzeste ne sont pas loin. Raoul Vaneigem non plus.
En France, les débats se sont focalisés dans les conflits entre Surréalistes, ce dont témoignent les manifestes successifs d’André Breton. La question des rapports entre esthétique et politique se ramène alors le plus souvent à l’adhésion, ou non, au Parti communiste, ou à frayer avec les satellites communistes et anarchistes, quand ce n’est pas avec le fascisme.
(Surréalistes et Jazz : Goffin, Leiris, in Malson...)
Aragon fera le choix du communisme. Pour lui, rapidement les problèmes ne seront pas prioritairement d’ordre esthétique, autour du réalisme socialiste, mais de résistance à la montée du fascisme. L’écrivain, toujours plus complexe qu’on ne le pense, défend en 1937, un réalisme de combat, « attitude de l’esprit ». L’oeuvre d’art est « résultat de cette lutte des éléments contradictoires d’un monde, d’une société dans un homme, des contradictions mêmes de cet homme ». Il se situe dans la ligne des orientations de Maurice Thorez pour conjuguer socialisme et ancrage national, et résister aux diktats de l’Internationale socialiste : le réalisme socialiste « ne trouvera dans chaque pays sa valeur universelle qu’en plongeant ses racines dans les réalités particulières, nationales, du sol duquel il jaillit ». (Congrès des écrivains soviétiques, 1954). Mais, comme pour Brecht, l’écrivain - l’artiste - Aragon établit dans son oeuvre un rapport au politique autrement subtil que dans sa vie publique.
Ces débats agitent les intellectuels et artistes communistes. Pour Garaudy, le réalisme doit démystifier la réalité présente, « défataliser l’avenir » ; l’art possède une dynamique prophétique, un caractère transcendant. Pour Pierre DAIX, à cette époque des « Lettres françaises » (celle de la mort de Staline et de la controverse autour de la publication de son portrait par Picasso), qui refuse d’opposer une avant-garde de la forme et une avant-garde du contenu, le réalisme de l’art agit au coeur de la modernité. (B , p. 156-157)
Henri Lefebvre, dans les années 70, propose l’oeuvre comme jeu, « quelque chose de plus et d’autre » , vers une « présence dans l’absence ». « Plusieurs moments coexistent en elle : « le moment de la forme » (par lequel elle acquiert sa cohérence), le « moment social » et le « moment extra-social » (qui lui permettent de puiser des matériaux, des exigences « allant parfois jusqu’à l’impératif politique »), et « le moment utopien ». Cette utopie, dans l’esthétique, instaure une réalité provisoire/éphémère, qui traverse des contradictions pour offrir des « potentialités de dépassement (...). L’art à travers sa phase critique, c’est-à-dire sa crise radicale, se manifeste... comme : création d’effets, représentation dépassée, pratique sociale, invention de formes, contribution décisive à la nature seconde ». (B , p. 157-158)
Convenons que ces engagements, qu’ils viennent de penseurs, de philosophes, ou d’artistes plus ou moins théoriciens de l’art et de la politique, sont très marqués par le rapport que chacun entretient au pouvoir : à « soutenir » dans les pays « socialistes », à conquérir par la Révolution ailleurs. L’Allemagne, entre l’URSS et la France, connaîtra les deux situations, comme certains de ses artistes : Brecht, Eisler... (voir Musique et politique en 3-2.3)
Rendons leur hommage, au passage, pour avoir mouiller leur chemise dans les combats de leur temps, et pas seulement en tant que penseurs en chambre.
Inversement, c’est leur relatif « éloignement », comme philosophes, des implications politiques concrètes, qui rend précieux les cheminements théoriques de ceux qu’on rassemble sous l’étiquette « Ecole de Francfort », d’Adorno et Horkheimer à Marcuse.
Auparavant, il est nécessaire de s’arrêter sur deux figures intellectuelles inclassables : Walter Benjamin (1892-1940) et Ernst Fischer (1918-).
Ami de Brecht et Adorno, parfois rattaché à l’Ecole de Francfort, Walter BENJAMIN est avant tout un libre penseur, c’est-à-dire un penseur libre, dans l’entre-deux guerres. Entre métaphysique du langage et héritage marxiste, il a de fulgurantes intuitions : sur la place de langage, à travers sa lecture de Kafka, Kraus, Proust ; l’intermittence signifiant/signifié ; le rapprochement de la doctrine talmudique et des thèmes marxistes ; et surtout, pour notre sujet, la théorie matérialiste de l’art.
A la dialectique forme/fond, il préfère « l’inscription de l’oeuvre dans le contexte social vivant » (B , p. 163). Il en situe la fonction au sein des rapports de production, « des états de choses » dans les situations quotidiennes. Il voit chez Brecht une démarche susceptible d’offrir au public une compréhension, une prise sur la réalité, rendant possible son désir et sa puissance de transformation. Le premier (hors les sombres impasses de Heidegger), Benjamin pense la question de la reproductibilité de l’oeuvre d’art, qui en modifie le statut : « Au temps de la reproduction, ce qui est atteint dans l’oeuvre d’art, c’est son aura ». (L’oeuvre d’art au temps de la reproductibilité technique, 1936).
L’accès des masses à l’art en détruit le fondement rituel. En revanche, l’oeuvre, accessible à tous, peut vivre sa vie et agir, provoquer des « chocs » dans la collectivité humaine, sortant de l’esthétique de simple contemplation. Contre le fascisme qui esthétise l’art, l’art se politise en ses fondements, changeant tout à la fois de forme, de contenu, et de fonction.
Ernst FISCHER (1918), philosophe autrichien, fait l’«Eloge de l’imagination », qui permet de comprendre le réel mais aussi de dessiner l’avenir. Il considère la volonté artistique comme essentielle pour lutter, dans les sociétés industrielles, contre l’aliénation, la fausse réalité, la fétichisation des choses. L’art moderne sollicite la participation de son public, qui devient actif dans l’interprétation. L’art ne peut être en marge de la lutte pour « l’être ou le non-être de l’humanité ». Il est, d’emblée, engagé.
Fischer sort l’art de sa position de superstructure idéologique. Parce qu’il a une claire conscience des enjeux de la modernité, et de la spécificité de l’art, « légitime défense de l’humanité », il avance des formulations précieuses pour aujourd’hui : « La révolte contre la passivité du public, l’effort multiple pour faire du consommateur d’art un acteur, même si cela doit se faire d’abord dans un déchaînement chaotique, l’art engagé et prenant ses distances avec tout engagement, pourraient revenir à une synthèse inattendue, comme jadis entre le Dionysiaque et l’Apollonien dans la tragédie grecque. » (A la recherche de la réalité, in Le Marxisme et l’art, Spartacus n°21, 1970, p. 277)