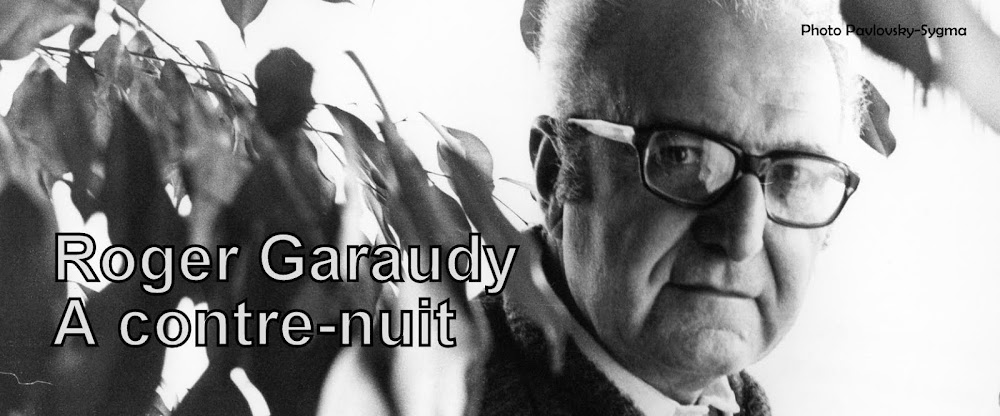«
— Pourquoi peignez-vous ?
«
— Pour tenter de devenir un homme, Monsieur. »
C'est
la réponse de Jean Lurçat à une interview de la télévision.
Cette
histoire proche commence mal : Jean Lurçat a 22 ans
lorsqu'éclate
la première guerre mondiale. Il restera toute sa vie « sur
le
front ». Pas seulement des tranchées de l'Argonne aux maquis du
Lot
en passant par la guerre d'Espagne. Mais sur tous les fronts où se
joue
le destin des hommes, et toujours du côté de ceux qui aiment
l'avenir.
Sans
optimisme béat : il y a le chaos, oui. Mais il existe des
forces
capables de le surmonter. Dans l'art comme dans la vie. Dans
la
poésie comme dans le combat.
Dans
ses tableaux de jeunesse, ceux de l'avant-guerre, du pendant-guerre
et
de l'après-guerre, ceux aussi de la crise de 1929, des craquements
qui
la précèdent, des écroulements qui la suivent, ce qui domine,
c'est
ce que Lurçat lui-même appelait « mon côté sinistre et Golgotha ».
Dans
un temps de guerre et de crise, d'incendies, de tortures, de prison,
de
faillite, de mort, peindre des ruines ou peindre des monstres est
un
phénomène d'époque.
Pas
des ruines romantiques, des décors pour la rêverie, à la
Hubert
Robert, ni des monstres aimables sortis des Métamorphoses
d'Ovide.
Mais les grands déserts calcinés avec leurs ossements de pierre
et
leurs squelettes d'arbres. Des bâtiments qui ne seraient habités par personne
comme
ceux des cauchemars de Chirico, ou des paysages
lunaires.
Comme si, dans ces toiles, s'annonçaient déjà les épouvantes
de
Guernica et d'Oradour. « Les hommes de notre génération ont vécu
deux
guerres, écrit Jean Lurçat. Et c'est dire que beaucoup de nos souvenirs
sont un
tissu d'hallucinations ».
Il n 'e n avait pas fini avec les
deux guerres : il y avait l'après-guerre
qui commence à Hiroshima ,
celui de l'épouvante atomique, celui
qu ' il résume dans les premières
pages du « Chant du Monde » : « ce
buffle qui essaime du poison sur tous les êtres créés ou à la veille d'être
engendrés... C'est pourquoi
toutes les bêtes», toutes les plantes qui se
trouvent dans la nef sont déjà
touchées, lépreuses parfois... Que la
bombe soit lâchée..., et toute la
création ne sera plus qu'un magma
empoisonné... Une innommable bouillie de pierrailles, de hurlements
et d'hommes éperdus comme il en fut
de Nagasaki ou d ' Hiroshima . »
Et voici , dans la même
tapisserie, l'homme à l a barre, l'homme
qui gouverne, le maître de la
création, avec tous ses possibles et pas
seulement ses enfers. « Voici
que, dominées par nous, l 'eau qui étouffe
et la flamme q u i consume
ensemencent le monde, le fécondent, l'engrossent.
Le froment se déhanche sous l'effort
et l a terre se fendille , s'ouvre
à la lumière ; les nuées, la chair des femmes, les toisons des chênes et
des vignes, les pierres même
prennent des aspects de feux... Le poète
est là, présent, dominant,
flanqué de rayons. Feu lui-même, engendreur,
archer tentant d'atteindre le coeur
des choses, le centre du cercle...
L'homme qui sait voir, et
croit, et aime savoir, retrouve dans
ces étranges figures, l 'eau , la terre, les vapeurs, les minéraux. Ces quatre
coins sublimes ou familiers où s'insèrent
les confiances, les espoirs, les
semences et les gestes de l'homme
qui chante face au soleil , les yeux
fichés droit dans l a lumière. »
Dans cette nouvelle « Apocalypse » de la laine, qui répond,
par dessus les siècles, à celle de
Jean de Bandol et Nicolas Bataille,
Jean Lurçat s'est dit
tout entier. Il a dit aussi notre époque et chacun
de nous. Avec ses angoisses et
ses espérances.
Il a trouvé pour le dire u n
langage collectif, à la fois noble et
populaire , comme celui des
fresques égyptiennes ou des céramiques
Crétoises,
ou des
masques des imagiers noirs, ou des grands mythes
figurés de l'Océanie ou de l 'art précolombien.
« Voici la maison où naissent
les étoiles et les divinités. » Ce
vers d 'Appolinaire,
repris par Jean Lurçat dans sa tapisserie « Es la
Verdad » , résume l 'univers de Lurçat, avec ses laines et ses couleurs q u i
naissent de mille ans d ' histoire, des entrailles de la terre et des rêves
des hommes.
Il retrouve et prolonge les mythes
profonds où se sont exprimées
les grandes visions de l'unité d u
monde et d u mouvement universel des
choses, où l'espoir s'enracine dans
le sens même de cette continuité des
êtres et de leur transformation sans fin.
Dans le fourmillement de
ces végétations étranges, où la feuille
devient plume ou écaille, où le
poisson se mue en végétal, où l'homme
fait si bien jonction
avec la poésie que son geste et son corps deviennent
arabesque, où l 'on ne distingue
plus les objets de la réalité de ceux
du rêve, où la vie se croise avec
le mythe pour former une même
trame, i l nous dit que tout est un
et que tout devient.
Jean Lurçat aimait à dire : « Avec mes cercles, mes soleils, je
suis comme u n prédicateur qui se
balade dans l a campagne en répétant :
il n'y a qu 'u n Dieu , un
seul Dieu , notre Dieu , tout est Dieu , etc . »
Il ajoutait : « La peinture,
tu sais, c'est plus que la peinture.
Ça touche tellement aux racines de la vie que, finalement, un croyant
peut trouver son compte dans la
peinture d 'un athée. »
Il était heureux, ce merveilleux
païen, chaque fois qu'on l ui
demandait de faire une tapisserie
pour u n autel d'église. Il y peignait,
comme dans toute son oeuvre, ce que
j 'appellerais « u n monde d'avant
la séparation », où la même sève de
couleur gonfle les bourgeons des
arbres et le sein des femmes, où l a
même onde de vie courbe l a branche
o u le bras. Le monde de la « participation» des plus vieux mythes des
hommes. Ce sentiment si profond que l'unité de tout était si directement
saisissable qu 'un croyant y
pouvait trouver sans doute la réponse
à sa foi : c'est ainsi qu'u n
mystique doit sentir Dieu fondre sur lui .
Lurçat nouait sa gerbe de couleurs
simples, dans une tapisserie où le
soleil avait des branches et l 'arbre des rayons, où l'homme était dans
la nature comme dans u n utérus. Ce
n'était ni le culte d u soleil ni celui
d 'aucun Dieu , mais un
chant d'homme. Il peignait comme il allait
au maquis. Il tricotait comme il
avait adhéré au Parti communiste.
Sa seule foi était cette unité
profonde, sa confiance en la création de
l ' homme. La laine était son
langage, sa manière de nouer tous les
fils de la vie.
Ses tapisseries étaient pour lui
une manière d'explorer le monde
et l'homme, l'homme avec toutes ses
dimensions, avec ses vestiges et
ses vertiges.
« Tu vois, je fais du tricot ! »
nous disait - il en guise d'accueil
lorsqu'on le surprenait au travail . Ce peintre de l'honneur de vivre
et de l a joie de créer tricotait,
en effet, ses hommes-arbres avec des
feuillages vivants, comme des joies
d'homme. Il créait un monde tissé
d'hommes, de végétaux et d'astres,
avec des soldats, des coqs ou des
soleils qui vous interpellent. A le
voir, débordant d'allégresse et de
vitalité, on avait l'impression qu ' il faisait partie de la trame de ses
tapisseries, ou qu'il était tricoté
de la même laine.
Un jour, il revenait du Moyen
- Orient, me rappelant le voyage
que nous avions fait ensemble en
Grèce l'année précédente, il me
parlait, avec son exubérance
habituelle et son enthousiasme, de la Vallée
des Rois en Egypte, puis de l a
Palestine et de la mer Morte. Pour lui
le sacré se révélait dans le
silence, la couleur, les formes, la grandeur.
II voulut me montrer ce qu'i l venait de faire, encore dans l'envoûtement
de ses souvenirs.
Il me fait asseoir et m 'entoure de huit dessins : stèle pour Attila,
tombeaux, etc. Le crayon
semblait avoir travaillé comme une navette
de tisserand, et il avait fait surgir une mythologie inquiétante et vivace :
des lianes envahissaient des ruines
et se juchaient finalement sur elles
comme u n drapeau sur une
forteresse, après la victoire. Celle de la v ie
sur la mort : « Tu vois, même si
toutes mes tapisseries brûlaient, je
resterais celui qui a dessiné ça.
Que penses-tu de mes dessins ? »
— Ils réveillent en moi des poèmes
de Saint John Perse.
« — Rien ne pouvait me faire plus
plaisir. Viens voir. »
Il me montra, sur sa table, les
deux volumes des poésies de
Perse publiées chez Gallimard. « J'en relis tous les matins quelques
pages avant de me mettre au travail. »
Le tapissier du soleil était bien de
la même race d'hommes
qu ' Heraclite ou Saint John Perse. Ce monde héraclitéen où tout est
vie et où tout ce qui est vivant est voué à une incessante métamorphose.
Ce monde héraclitéen dont la
substance primordiale est le feu.
Le bestiaire de Lurçat, sa flore du jardin d ' Eden, est le langage
de ce monde en gésine, son allégorie
heureuse. Chaque tapisserie fait
sourdre d u m u r une verdure, un grouillement de vie, non pas silencieuse
comme une moisissure ou une mousse,
mais avec des fanfares de
couleurs, comme dans un vitrail où la lumière viendrait de derrière
le mur. La laine filtre
cette lumière, la laisse filtrer jusqu'à nous, comme
dans les forêts, surtout les forêts
mystérieuses qu 'on imagine, comme
celle de Brocéliande, fourmillantes de miracles et d ' exploits.
Cette fermentation de formes
inextricablement nouées au lacis
des rêves prolonge les arts les plus
anciens et les plus populaires, depuis
celui des cavernes de Lascaux et
d ' Altamira, où les chevaux sauvages,
les bovidés et les rennes se
superposent et s'emmêlent selon les lois
inconnues des terreurs et des
magies, jusqu'à celui des chapitaux romans
où le sculpteur pliait les bêtes et
les hommes selon l'architecture
de Dieu.
Toute cette féerie est tournée
vers l'avenir : « Il faut chanter
l ' homme au delà de son
aigreur, disait Jean Lurçat, croire aux féeries ;
de l ' homme nous ferons un jour une fée pour tous les hommes... Dans
cinquante , dans cent ans,
on ne peindra plus Buchenwald ni Oradour,
ni les barricades, ni nos martyrs :
on peindra la joie d'avoir dépassé
tout cela : mes tapisseries ne
seront plus insolites. Je lutte dans ma vie
d'homme pour que mes semblables, mes
frères, soient à l'aise dans la
nature comme le sont les figures que
je peins en laine. »
Il a tourné vers l 'avenir
son grand miroir de laine , et l 'avenir
est venu s'y refléter comme dans un
miroir convergent, où toutes les
tensions de l'homme vers ce que le
monde, par son effort, pourra
devenir, se trouvent exprimées avec
le maximum de concentration,
d'intensité et de feu. Comme si le
regard de l'artiste était fait pour
refléter ce qui n'existe pas encore.
Tant d'étendards et tant
d'étoiles, plantés sur le vieux monde,
pour l'exalter, pour l'illuminer, pour y faire vivre l'espoir et l 'exploit.
De « l 'Apocalypse
d'Angers » au « Chant du Monde » , de
Lurçat, il y a d 'abord la
grande continuité des craintes et du vouloir
des hommes. Une montée aussi d u
pouvoir des hommes. Si la réalité
fondamentale de la vie, au temps de
Nicolas Bataille, c'était la peur
de l'enfer, au temps de Jean Lurçat,
c'est la puissance de l'homme,
régent de la création continuée de
l'homme par l'homme.
Mais il y a aussi la grande
continuité d'une technique répondant
aux exigences d 'un art collectif, populaire, monumental.
Jean Lurçat, c'est la
renaissance de la tapisserie française d'abord
parce qu'il a trouvé les lois
fondamentales de la tapisserie par delà
quatre siècles de décadence, et
ensuite parce qu ' il ne s'est pas contenté
de les redécouvrir : il les a fait
vivre, d'une vie nouvelle en concevant
la tapisserie d u 20e siècle à partir des techniques
picturales du cubisme
et des fauves, à partir aussi
de la poésie du surréalisme.
Il nous reste donc à définir à
grands traits ce que j 'appellerai
son esthétique de la grande inversion.
Lorsque, sous le choc qu'il éprouva,
en 1937, devant la prodigieuse
suite des tapisseries de « l ' Apocalypse d'Angers » , réalisée a u 14e
siècle par Jean de Bandol et Nicolas Bataille, Jean Lurçat fit revivre
Aubusson , la tapisserie
avait perdu, depuis des siècles, son langage
propre.
Jean Lurçat ne se lassait pas de
redire les causes de cette dégénérescence
; perdant le sens de la vocation murale et monumentale,
depuis des siècles l 'on s'était
follement appliqué à éloigner la tapisserie
de la fresque pour lui faire
copier le tableau de chevalet.
Les Gobelins ruineux et
pisseux d u 17e
et d u 18e siècle s'acharnent
vainement à rivaliser avec la
peinture à l'huile. Mais entre chaque
couleur du tableau original et sa traduction en laine , il y a un décalage,
car le teinturier n'a pas
la possibilité de réaliser les mélanges subtils et
chaque fois uniques de la palette.
Des milliers d'à peu près accumulés
font un tableau désaccordé. La logique d 'un tel système obligeait à m u l -
-tiplier sans fin les nuances :
du temps de Nicolas Bataille, on a utilisé
pour le chef-d'ccuvre de l ' Apocalypse, une vingtaine de tons pour les
laines, au 18* siècle, on en a
fabriqué 600 pour reproduire les mièvreries
des petits maîtres d'alors et, en
1930, aux Gobelins, près de 3000 , ce
qui aboutissait à l'impasse : le
mètre carré de tapisserie coûtant plus cher
que le tableau authentique pour une
reproduction nécessairement infidèle.
Alors Jean Lurçat vint. Et il
inversa radicalement les données
du problème. Au lieu de partir
de la fin, c'est-à-dire de ce dogme que
la tapisserie a pour fin de
reproduire des tableaux, il est parti d'une
réflexion sur les moyens propres à la tapisserie, sur son langage spécifique.
E n 1736, le peintre Oudry,
superintendant de la Manufacture
royale des Gobelins définissait,
dans une circulaire, l'esthétique
de la tapisserie ; il donnait cette
directive : « Les tapisseries devront
désormais donner à leurs ouvrages
tout l'esprit et toute l'intelligence
des tableaux, en quoi seul réside le
secret de faire des tapisseries de
première beauté ! »
C'était l'arrêt de mort contre l a
tapisserie, condamnée en tant
qu ' art indépendant et original, et vouée à n'être que le reflet d'un
tableau.
Faire revivre la tapisserie
exigeait que l 'on prit le contrepied de
la conception d 'Oudry. C'est ce que fit Lurçat.
D ' abord, rendre à l a
tapisserie ses fonctions et son site : comprendre
sa destination murale
et populaire. A la grande époque, celle
des chefs-d'oeuvre de l'« Apocalypse d'Angers » ou de la « Dame à
la Licorne », la tapisserie
n'était destinée ni aux musées ni aux boudoirs
des princesses : elle servait à couvrir les murs rugueux d'une salle des
gardes, ou les arènes d 'un tournoi , les façades d'une rue ou les nefs
des églises. Avec 144 mètres de
longueur sur 5 de hauteur, la suite
de l ' Apocalypse, qui
était d 'un seul tenant avant ses découpages, était
destinée à couvrir d'immenses
surfaces, à saisir le regard des foules.
Lurçat veut rendre à l a tapisserie,
— et à l 'art en général, —
cette fonction collective,
même si les sites sont nouveaux, s'il s'agit
aujourd'hui de tapisser
des universités, des mairies ou des aéroports.
Replacée dans cette perspective et
couvrant de grandes surfaces,
la tapisserie doit affirmer son
esthétique et ses lois propres. Il ne peut
plus être question de raffiner sur
des détails infimes, comme dans un
art individualiste
livré à l'inspection des monocles et des face-à-mains.
Le monumental exige les grandes
simplifications des mosaïques de
Ravenne ou des fresques de Tavant. Il exige la puissance de grands
ensembles structurés, un travail par
grandes masses. Giotto et non
pas Bouguereau.
Lorsque Lurçat fait sourdre des murs
ses végétations de formes,
regardez : ses touffes de feuilles ou d'étoiles, de papillons ou de flammes,
de coqs ou de zodiaques, dès que
vous vous éloignez de quelques pas,
s'ordonnent selon les nervures
fondamentales de la composition et
obéissent au rythme de l'ensemble, à
la houle majestueuse qui déferle,
toujours vivante et toujours
cadencée, même sur les 500 mètres carrés
du « Chant du Monde ».
Toutes les découvertes plastiques du langage de la peinture au
2 0e siècle sont, par Lurçat, mises en oeuvre en fonction de son dessin
primordial. La couleur pure des impressionnistes et des néo-impressionnistes
s'impose dans la tapisserie plus
qu 'ailleurs: ici décrasser la palette
de ses bitumes est une nécessité
absolue, car la tapisserie est une surface
rugueuse, inégale, avec mille
petits ravins qui s'y creusent entre chaque
fil de laine : à cinq fils par
centimètres, comptez combien cela fait de
cannelures, et, dans chacune de ces
minuscules vallées, l'ombre s'accu-
mulant pour cerner et ronger
la couleur. Il faudra donc à la fois hausser
le ton pour compenser ce
grignotage, et éviter les tons rompus. Là encore
l'esthétique de la grande version de
Lurçat commence par une rupture
du point de vue technique : au lieu de partir du tableau et de ses
couleurs pour s'acharner vainement
ensuite à en reproduire les nuances
à coups de teinturerie,
Lurçat part de la matière elle-même, de la laine.
Il pense directement en laine : il
sélectionne une vingtaine de teintes
pour leurs qualités physiques de
brillance et de résistance chimique,
et il s'astreint à parler ce seul
langage dans ces cartons.
Les lois des contrastes simultanés
de couleurs avaient été découvertes
aux Gobelin s même, il y a
plus d 'un siècle, par Chevreul, prenant
conscience que chaque couleur,
colorant les plages qui l'entoure de sa
complémentaire, deux complémentaires
juxtaposées s'exaltent et qu ' inversement,
deux couleurs non complémentaires
juxtaposées s'éteignent mutuellement.
Indépendamment de Chevreul,
les impressionnistes, surtout
les néo-impressionnistes, comme
Seurat ou Signac, avaient mis en oeuvre
ces lois . Mais, paradoxalement,
la tapisserie n ' en avait tenu aucun compte.
Il faudra Lurçat pour qu'à partir
de 1937 elle retrouve son intensité,
sa brillance, ce qu ' en
terme technique les tapissiers appellent « son feu »,
ce mot qui convient si bien à Lurçat dont l ' univers, comme celui d'Hera-
clite, semble avoir pour
substance dernière le feu.
Contre les dégradés subtils,
les ombres lentes, la multiplication
à l ' infini des nuances,
contre tout ce qui faisait, depuis quatre siècles,
de la tapisserie, un reflet affaibli, terne, délavé, d 'un tableau, Lurçat
travaille par grands contrastes
colorés dont il varie le jeu selon les
lois majeures de la puissance.
Les mêmes exigences conduisaient
nécessairement à l 'abandon
de la perspective classique : maintenir les principes de la perspective
géométrique ou de la perspective
aérienne, tels que les avaient définis
Alberti ou Léonard à la
Renaissance, conduisait à encombrer les lointains
et les fonds d ' un fouillis
de formes minuscules réduites le long des lignes
de fuite, à empâter par des contours
flous les figures éloignées, à les
dissoudre dans une buée bleuâtre,
toutes conséquences meurtrières, mortelles,
pour la fraîcheur de l'oeuvre.
Jean Lurçat a recueilli la
leçon maîtresse du cubisme et de son
traitement de l'espace : il s'en
tient rigoureusement à la surface du
mur, là où l' architecture constitue elle-même la bordure et le cadre
de sa tapisserie, où l'architecture
commande qu 'on ne troue pas le
mur par les trompe l'oeil de l a
perspective ou les modelés du relief mais,
qu ' au contraire, on en respecte
strictement la surface plane et pleine.
Les à-plats de couleur, comme le
rejet de la perspective classique,
nous introduisent ainsi dans un
espace qui n'est plus celui que nous
parcourons dans les rues ou les
décors de théâtre, mais une sorte
d'espace primordial qui
évoque le « grand temps » des mythes : il était
une fois... Un espace frère de ce
temps d u mythe, l'espace même de la
création mythique, de
l'affranchissement surréaliste du rêve et de la
poésie.
La technique, ici, ne fait qu '
un avec la conception du monde
et la conception de l'art. Le
sortilège de Lurçat, c'est cette parfaite
adhérence du langage au message, du
mode d'expression à la manière
de sentir, de vivre et de chanter la vie.
Dans cette oeuvre si diverse, c'est
là ce qui fait l'unité profonde
de Lurçat, sachant tordre d ' un
poing vainqueur tous les contrastes,
comme écrivait Verhaeren.
Tous ces Lurçat qui sont un seul Jean, celui
que nous aimons dans sa colère et
dans son bonheur, dans sa force
contradictoire et multiple: Lurçat couleur des paons et Lurçat comme
un incendie ; Lurçat des
apocalypses et des hymnes à la joie; Lurçat plein
de soleil et criblé d'étoiles ;
Lurçat des épouvantes et Lurçat de l'espoir.
Jean, promesse du matin.
Roger G A R A U D Y
Présentation du catalogue de l’exposition Lurçat au Musée
des Ponchettes à Nice (25 juillet-25août 1968)
Les tapisseries présentées à cette exposition ont été tissées à Aubusson aux ateliers Goubely, Legoueix, Picaud, Pinton, Tabard.
Les photographies du catalogue sont de Gérald Bloncourt, Paul Buer, Janine Niepce, Roger Pic, Routhier.
Les tapisseries présentées à cette exposition ont été tissées à Aubusson aux ateliers Goubely, Legoueix, Picaud, Pinton, Tabard.
Les photographies du catalogue sont de Gérald Bloncourt, Paul Buer, Janine Niepce, Roger Pic, Routhier.
Liberté - Tapisserie - 1943